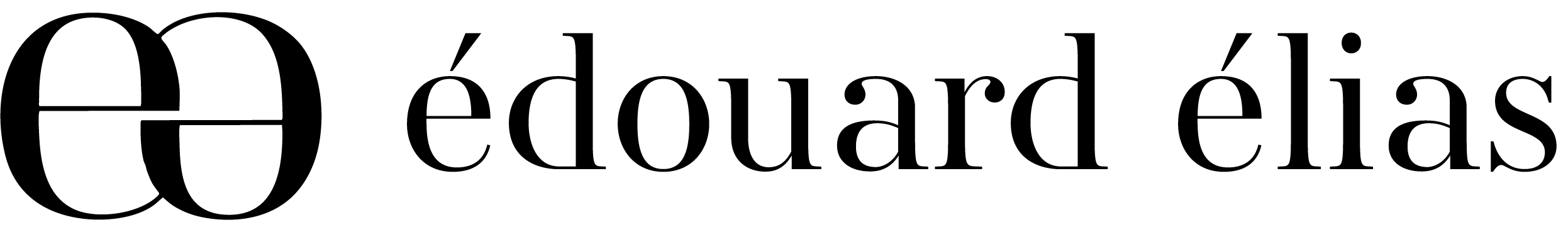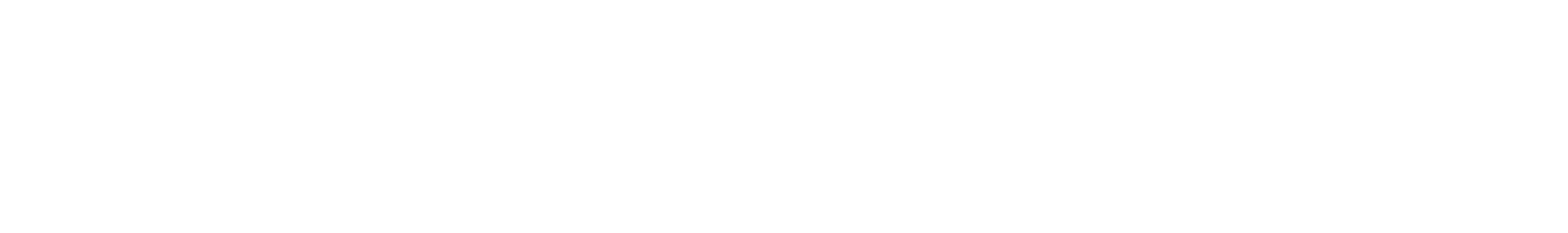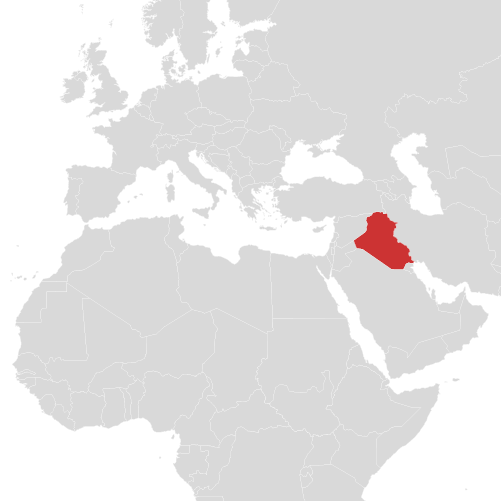Le puits 77.
Alors que la bataille de Mossoul se prépare, la guerre contre l’État islamique entre dans une nouvelle phase. Après des mois de recul, les forces irakiennes, appuyées par la coalition internationale et des unités kurdes, lancent l’assaut final sur la dernière grande ville tenue par Daesh en Irak. Dans leur sillage, des villes sont reprises, parfois rue par rue, parfois maison par maison. C’est le cas de Qayyarah, petite bourgade du nord du pays, située sur les rives du Tigre, à une soixantaine de kilomètres au sud de Mossoul.
Occupée depuis juin 2014, Qayyarah était un site stratégique pour les djihadistes. Non pas tant pour sa population – 15 000 habitants tout au plus – que pour ce qu’elle cache sous terre : un gisement de pétrole très lourd, peu rentable à l’échelle industrielle, mais crucial pour l’économie de guerre de Daesh. Le brut y était pompé sommairement, stocké dans des fosses creusées à la hâte, puis redistribué via des camions-citernes, parfois anonymes, parfois immatriculés en Irak ou en Syrie. Ce carburant alimentait notamment les générateurs électriques de Mossoul et le marché noir de l’EI.
« À côté de chaque puits, ils avaient creusé des bassins. Des camions venaient le pomper. Le baril se vendait entre 12 et 15 dollars », explique Nazar Jallal, responsable média de la compagnie pétrolière Naft Shamal.
Quand les forces irakiennes approchent, les hommes de Daesh sabotent les installations. Ils posent des mines, font exploser les têtes de puits, ouvrent les valves. Dix-huit puits prennent feu. Une guerre du feu commence.
À Qayyarah, la guerre ne se joue plus à la kalachnikov mais au pétrole en feu.
C’est là qu’intervient une unité méconnue : les pompiers de Naft Shamal, compagnies pétrolières publiques irakiennes. Spécialistes du feu industriel, ils affrontent, jour après jour, la flamme du puits 77, l’un des plus puissants foyers d’incendie du champ pétrolier.
« Il nous a encore eus aujourd’hui. Il a encore gagné », dit Mohamed Ahmed, la moitié du visage brûlée par un retour de flammes.
Autour de lui, la terre est noire, l’air irrespirable. Une flamme gigantesque, large comme un immeuble, ronfle, grogne, s’élève et s’affaisse comme une monstrueuse respiration, écrit Gwenaëlle Lenoir.
Les hommes avancent en silence. Leurs gestes sont précis, mécaniques, fatigués. Ils portent des combinaisons rouges, des foulards, des masques rudimentaires. Ils avancent protégés par des cahutes de tôle poussées par des bulldozers.
« On refroidit la terre autour du puits, explique Satar Abduljabbar. Puis on la dégage avec la pelleteuse. Et on recommence. »
Le brasier est trop fort pour être attaqué de front. Il faut le contourner, l’affamer lentement, comme on étoufferait un animal enragé. Pendant des heures, les hommes s’approchent, injectent de l’eau salée et du ciment à l’aide d’un engin de chantier archaïque, noirci, luisant, protégé en continu par des jets d’eau.
« La température atteint 700 degrés. Et l’explosion des mines a tordu la tête. C’est difficile d’injecter le produit assez profondément. »
Ce feu-là n’est pas un accident : c’est un acte de guerre. Un héritage brûlant laissé par Daesh pour paralyser toute reprise économique, pour contaminer la terre, les eaux, les poumons.
Les images de Qayyarah en 2016 rappellent un autre enfer : celui du Koweït en 1991, après la première guerre du Golfe. Là aussi, les puits avaient été sabotés, incendiés par les forces irakiennes en retraite. Le ciel s’était obscurci pendant des semaines, des nappes de pétrole avaient noirci le sable, et les flammes rouges se reflétaient dans des lacs de brut en ébullition. Qayyarah, en 2016, rejoue cette scène : un paysage lunaire, détruit par le feu, où les hommes semblent minuscules face à la furie du pétrole en feu.
Mais ici, la guerre est double : les combats se poursuivent à Mossoul, les attentats frappent Bagdad, et les ingénieurs et pompiers doivent lutter avec des moyens dérisoires. Leurs engins datent parfois des années 1950. Il n’y a pas de nitroglycérine comme dans Le Salaire de la Peur, seulement de la méthode, de l’endurance, et une forme d’entêtement.
« La tension, l’épuisement, l’excitation, aussi, se lisent dans tout le corps des hommes qui mènent le corps à corps pendant des heures », écrit Gwenaëlle Lenoir.
Sous le feu, pas de héros ni de slogans, juste une lutte quotidienne contre un élément qui déborde tout : la chaleur, l’obscurité, la respiration du brasier, sa logique propre. Il se peut que le puits gagne encore demain. Mais les hommes reviendront.
Parce qu’ils n’ont pas le choix.
Parce que ce sol est le leur.
Et parce que c’est là que la guerre continue.